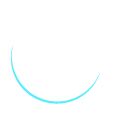Selon une évaluation réalisée en 2015, 61 % de la population haïtienne vivait à plus de deux kilomètres d’une route praticable en toutes saisons, et la plupart des routes rurales étaient en si mauvais état qu’elles étaient à peine praticables. En fait, même si les efforts récents pour améliorer le réseau routier ont augmenté la connectivité interurbaine, la moitié du pays reste mal connectée. Certaines régions sont totalement isolées pendant plusieurs jours pendant la saison des pluies, qui s'accompagne souvent de tempêtes et d'ouragans majeurs.
En Haïti, le réseau routier est limité à environ 3 450 km (700 km de routes nationales, 1 500 km de routes départementales et 1 200 km de routes tertiaires pour un territoire d’environ 27 750 km2. En comparaison, le Burundi (27 834 km2) compte 12 322 km de routes.
« L’absence d’infrastructures de transport engendre un manque d’accès aux services de base ou même aux marchés publics pour vendre les produits agricoles. En saison des pluies et lorsque des catastrophes surviennent, les rivières débordent et les glissements de terrain coupent l’accès aux routes principales. Cela réduit la possibilité d’accéder aux services des deux côtés », a expliqué Jonas Robinson Leger, coordonnateur de l’Unité Centrale d’Exécution, du ministère des Travaux publics, transports et communications. « Il est essentiel de combler ce fossé pour garantir à chaque Haïtien des opportunités, car les infrastructures sont essentielles à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté et renforcent également la résilience du pays face aux catastrophes naturelles. »
Avec le soutien de la Banque mondiale et d’autres partenaires, le gouvernement a développé l’outil Indice d’accès rural visant à répondre aux besoins en infrastructures. L'outil vise à renforcer la connectivité par tous les temps en construisant des ponts, des dalots, des murs de soutènement, entre autres. Sur certains axes critiques, du béton y est ajouté aux segments de route pour atténuer l’impact des catastrophes naturelles sur la connectivité interurbaine.
« On peut prendre l’exemple de la ville de Maissade, dans le département du Centre, où il n’y a pas un important centre hospitalier ni de banque commerciale. Les habitants doivent traverser les rivières Rio Frio, Bonbon et Nahan, qui coupent la route principale en trois sections différentes, pour accéder aux services de santé ou économiques. Entre décembre 2019 et avril 2022, nous avons construit les ponts et les ponceaux en béton nécessaires pour permettre une circulation abordable. Désormais, même pendant les jours de pluie, les gens peuvent facilement se déplacer de Maissade à Hince, et vice-versa, sans craindre d’être touchés par les inondations ».
Globalement, au cours des 15 dernières années, les projets de transport financés par la Banque mondiale ont contribué à stabiliser les segments Marigot-Jacmel et Port-Salut-Les Anglais ; et plus de 350 km de routes ; reconstruit les ponts de Chalon, Dolin, Fauché, La Thème et Boucan Carré avec des méthodes résilientes ; réhabilité et renforcé 210 petits ponts, ponceaux et renforcé et réparé plus de 28 ouvrages d'art.
Innover pour répondre plus rapidement aux catastrophes
En 2016, l’ouragan Matthew a affecté plus de 2 millions de personnes, soit environ 20 % de la population d’Haïti, principalement dans les régions les plus pauvres du pays. Il a également provoqué des inondations, des glissements de terrain et la destruction massive d’infrastructures et de moyens de subsistance. Les dégâts sur le transport routier ont été importants : 1 200 km de routes primaires, secondaires et tertiaires ont été endommagés à des degrés divers. Vingt-neuf ouvrages d'art ont été endommagés, dont le pont de Ladigue, du côté de Petit Goâve, dans le département de l'Ouest, qui a été détruit. Le coût total des pertes et des dommages a été estimé à 208 millions de dollars américains selon le Post Disaster Needs Assessment.
Sur recommandation du Gouvernement haïtien, les projets d’infrastructures financés par la Banque mondiale ont permis de stocker des ponts d’urgence pour permettre une réponse rapide afin de reconnecter des communautés sans ou avec peu de procédures administratives. En temps normal, les procédures pour lancer la construction d’un pont peuvent s’étendre sur une année, ce qui représente un délai très long dans un processus de rétablissement après une catastrophe.
De 2014 à 2020, les projets financés par la Banque mondiale ont permis d’acheter 28 ponts temporaires. Cette solution innovante a permis l’installation rapide d’un pont sur la rivière Ladigue après le passage de l’ouragan Matthew pour reconnecter le pays à l’ensemble des 2 millions d’habitants de la région des Nippes, du Sud et de la Grand’Anse. Récemment, cela a permis au gouvernement de rétablir la connectivité entre la population de la Grand’Anse et le reste du pays après le terrible tremblement de terre de 2021 qui a frappé la région sud d’Haïti.
Maintenir la connexion, malgré les défis
Aujourd’hui, le secteur des transports représente le segment le plus important du portefeuille de la Banque mondiale en Haïti, soit 28 % du total de 1,3 milliard de dollars. Grâce à ce financement, le gouvernement entreprend des travaux d’entretien urgents sur la piste de l’aéroport du Cap-Haïtien. Cela facilitera la circulation des avions tout en augmentant le niveau de sécurité. Parallèlement, le projet principal comprend la construction d'une tour de contrôle, visant à régulariser le transport aérien, à augmenter le niveau de sécurité des voyageurs et à redimensionner la piste pour l'adapter à la demande croissante.
Parallèlement, le gouvernement travaille à la construction de plusieurs segments routiers dans la ville historique du Cap-Haïtien tels que la route SOS, le segment Vertières – Fort St Michel (5 KM + un pont de 48 mètres sur la rivière Haut du Cap) qui permettront également de minimiser le trafic et d’augmenter la mobilité à l’intérieur de la ville. Dans la région sud, les projets d’infrastructures comprendront également la réhabilitation du tronçon routier Cayes – Torbeck, qui est en très mauvais état, ainsi que le traitement de plus de 100 points critiques dans les petites villes et les zones rurales.
Le secteur des infrastructures est tout aussi affecté par le contexte général du pays, caractérisé par une situation sécuritaire tendue et une atmosphère politique volatile. Parmi les contraintes, les entreprises internationales hésitent à soumissionner pour les contrats, les ressources humaines locales qualifiées ont tendance à quitter le pays, les matériaux essentiels n’arrivent pas sur les chantiers à temps et le difficile accès au carburant sont entre autres facteurs qui retardent l’exécution des projets.
L’Unité Centrale d’Exécution élabore des stratégies pour contourner les goulots d’étranglements qui ralentissent l’implémentation des projets. « Nous utilisons désormais la plateforme électronique Bonfire pour réaliser les appels d’offres. Cela facilite le processus d’approvisionnement, tout en réduisant l’exposition du personnel. Comme la plupart de nos activités se déroulent en dehors de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, nous disposons désormais de bureaux satellites dans les régions qui nous permettent d’être plus mobiles dans nos travaux de supervision », a relaté ingénieur Leger.