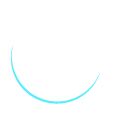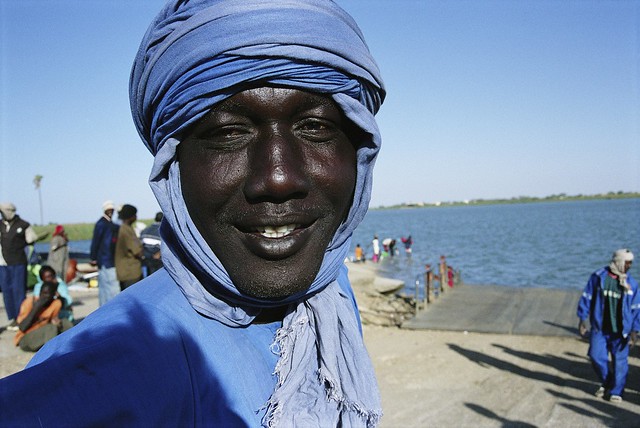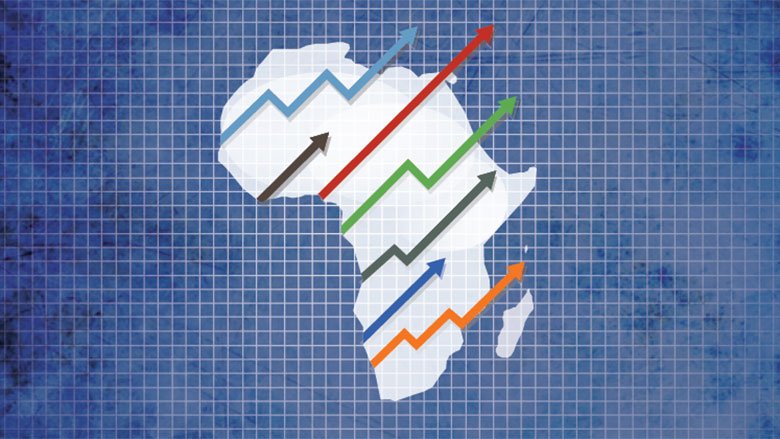La République démocratique du Congo (RDC), possédant une superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale, est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne (ASS). La RDC est dotée de ressources naturelles exceptionnelles, notamment de minerais tels que le cobalt et le cuivre, d'un potentiel hydroélectrique, des terres arables importantes, une biodiversité immense et la deuxième plus grande forêt tropicale du monde.
Cependant, la majeure partie de la population congolaise ne bénéficie pas de cette richesse. Une longue histoire de conflits, de bouleversements politiques et d'instabilité, ainsi qu'un régime autoritaire, ont conduit à une crise humanitaire grave et permanente, qui a été exacerbée depuis novembre 2021 avec la résurgence de l'activisme du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation a aggravé une crise humanitaire déjà désastreuse, avec des millions de personnes déplacées et des centaines de cas de violence sexuelle et sexiste. En outre, des populations ont été déplacées de force. Le pays est enlisé dans ce cycle de violence et d'instabilité depuis la fin des guerres du Congo en 2003.
La RDC fait partie des cinq pays les plus pauvres du monde. 73,5 % des Congolais environ ont vécu avec moins de 2,15 dollars par jour en 2024. Environ une personne sur six vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vit en RDC.
Situation politique
En décembre 2023, la RDC a organisé des élections générales qui ont abouti à la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat de cinq ans. Son investiture a eu lieu le 20 janvier 2024. Le parti de Tshisekedi et ses alliés ont remporté la majorité des sièges au parlement, consolidant ainsi leur pouvoir politique.
Le 1er avril 2024, Judith Sumwina Tuluka a été nommée première femme Premier ministre après de longues négociations. Son arrivée au gouvernement constitue une avancée significative pour la représentation des femmes dans les hautes sphères de l'État. Un nouveau gouvernement a été formé en mai 2024, avec de grandes attentes en matière de réforme et de gouvernance.
La résurgence du groupe rebelle M23 au cours des derniers mois a considérablement entravé l’élan de la RDC vers le chemin de paix et de développement. Actuellement, près de 20 % du territoire national est contrôlé par les rebelles après la chute des villes et territoires importants dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Cette situation a divisé le pays en deux blocs, soulevant de nouvelles incertitudes alors que les rebelles continuent de progresser, dans le but de contrôler davantage de provinces. La situation sécuritaire en Ituri est également instable, en raison des conflits intercommunautaires et des groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources minières et des territoires.
Malgré ces défis, le gouvernement s’emploie à renforcer la présence et la crédibilité de l'État, améliorer la gouvernance et faire avancer les réformes structurelles pour restaurer et maintenir la stabilité et la paix, attirer les investissements et créer des emplois.
Situation économique
L'économie continue de faire preuve de résilience, avec une croissance de 6,5% en 2024, contre 8,6% en 2023. Cette croissance résulte principalement de l'industrie extractive, qui a augmenté de 12,8%. Les secteurs non miniers ont augmenté de 3,2 % en 2024, soutenus par la construction et les services. Le déficit de la balance courante (CAD) s'est réduit à 3,4 % du PIB en 2024, en raison de l'augmentation des exportations minières. Les investissements directs étrangers (IDE) et les financements extérieurs ont porté les réserves de change à 2.5 mois d'importations à la fin de 2024 (contre deux mois en 2023), limitant ainsi les fluctuations du taux de change. Le CDF s'est déprécié de 8,7 % à la fin de 2024 (contre 17,9 % en 2023), entraînant une baisse de l'inflation à 11,3 % à la fin de l'année.
La croissance du PIB devrait ralentir à 5,1 % en 2025 et se modérer à 5,5 % en 2027, en raison du ralentissement de l'expansion de la production minière. Les secteurs non miniers soutiendront progressivement la croissance, atteignant 5,9 % en 2027 (contre 3,8 en 2025), portés par la construction et les infrastructures. Le CAD devrait se creuser pour atteindre 3,7 % du PIB en 2025 en raison de l'interdiction temporaire des exportations de cobalt de la RDC, mais devrait se réduire à 2,7 % du PIB d'ici 2027 grâce à l'augmentation des recettes d'exportation du cuivre.
Une position extérieure solide et l'absence de financement du déficit budgétaire par la BCC favoriseront la stabilité de la monnaie et permettront de contenir l'inflation à l'objectif à moyen terme de 7 %. Cependant, les risques sont titrés à la baisse, avec l'escalade continue du conflit dans l'est, les épidémies persistantes (mpox) et les conflits mondiaux, qui pèsent encore plus sur les dépenses publiques. Pour relever les défis en RDC, il faut un engagement national et international important pour renforcer les structures de gouvernance, soutenir les mécanismes de résolution des conflits et restaurer la sécurité et l'autorité de l'État.
Contexte social
La RDC est classée 164e sur 174 pays dans l'indice du capital humain 2020, reflétant des décennies de conflit et de fragilité, et limitant le développement. L'indice du capital humain de la RDC est de 0,37, ce qui est inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne (0,4). Cela signifie qu'un enfant congolais né aujourd'hui ne peut espérer réaliser que 37 % de son potentiel, par rapport à ce qu'il aurait pu faire s'il avait bénéficié d'une expérience scolaire complète et de qualité et de conditions de santé optimales. Le faible taux de survie des enfants de moins de cinq ans, le nombre élevé de retards de croissance chez les enfants et la mauvaise qualité de l'éducation sont les principaux facteurs à l'origine de ce faible score.
La RDC a l'un des taux de retard de croissance les plus élevés d'Afrique subsaharienne (42 % des enfants de moins de cinq ans) et la malnutrition est la cause sous-jacente de près de la moitié des décès d'enfants de moins de cinq ans. Contrairement à d'autres pays africains, la prévalence du retard de croissance en RDC n'a pas diminué au cours des 20 dernières années. En raison du taux de fécondité très élevé, le nombre d'enfants souffrant d'un retard de croissance a augmenté de 1,5 million.
La RDC abrite un large éventail de peuples autochtones (PA) qui ont dû faire face à toute une série de défis, notamment le déplacement forcé de leurs terres ancestrales, la discrimination et le manque d'accès aux services de base tels que les soins de santé et l'éducation. Malgré ces difficultés, les PA de la RDC continuent de jouer un rôle important dans la préservation de la diversité culturelle du pays et dans la promotion de pratiques de gestion durable des ressources. Bien que des efforts soient faits pour reconnaître et protéger les droits des PA, il reste encore beaucoup à faire pour assurer leur pleine participation à la société et la protection de leurs modes de vie traditionnels.
Accès à l'éducation : Dans l’ensemble, le nombre d'enfants inscrits dans l'enseignement primaire a augmenté de manière significative, passant de 11,9 millions (10,7 millions dans les écoles publiques) en 2010-2011 à 16,1 millions (14,2 millions dans les écoles publiques) en 2018-2019, pour atteindre 21,3 millions (18,7 millions dans les écoles publiques) en 2023-2024. Au cours de la même période, les inscriptions dans l'enseignement secondaire ont doublé, passant de 2,3 millions à 6 millions, puis à 7,5 millions. Cependant, le secteur de l'éducation reste confronté à des défis en matière d'accès, d'équité et de qualité, en particulier pour les filles et les enfants d'origine modeste. Si les inégalités entre les sexes dans l'enseignement pré-primaire et primaire ont diminué au fil du temps, les filles ont toujours moins de chances que les garçons de fréquenter et d'achever l'enseignement secondaire.
L'expansion du secteur de l'éducation a lieu dans un environnement caractérisé par des inefficacités internes et de faibles résultats d'apprentissage. Une crise de l'apprentissage aux niveaux élémentaires, poussée par l'expansion rapide de l'enseignement primaire, se poursuit dans l'enseignement secondaire. Cette situation, associée à une main-d'œuvre jeune et sous-qualifiée, pose des risques pour la productivité future de l'économie congolaise.
La femme congolaise fait face à des obstacles importants en matière d'opportunités économiques et d'autonomisation, y compris des taux élevés de violence basée sur le genre (VBG) et de discrimination. Seules 16,8 % des femmes ont terminé l'école secondaire, soit environ la moitié du taux d'achèvement des hommes. Les mariages précoces et les taux de fécondité élevés représentent un véritable défi. Les femmes et les filles qui ne bénéficient pas d’une éducation ont un taux de fécondité deux fois supérieur à celui des femmes ayant terminé l'enseignement secondaire (7,4 enfants contre 2,9 [EDS 2014]). La moitié des femmes déclarent avoir subi des violences physiques et près d'un tiers des violences sexuelles, le plus souvent de la part d'un partenaire intime (EDS 2013).
Le taux de participation des femmes à la population active en RDC est estimé à près de 62%, la plupart d'entre elles travaillant dans l'agriculture. Bien que le taux de participation soit relativement élevé, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes et possèdent moins d'actifs. Un rapport de diagnostic sur le genre de la RDC de 2021 identifie trois facteurs majeurs contribuant à la persistance d'écarts importants entre les hommes et les femmes : le contrôle des terres, la capacite d’expression et d’action, ainsi que le risque et l'incertitude, y compris la vulnérabilité aux chocs et à la violence de genre.
Les systèmes de soins de santé de la RDC ont été fortement affectés par les conflits prolongés dans le pays, et les crises humanitaires complexes continue dans le monde. Cette situation a été fortement aggravée par la pandémie de COVID-19 et par les épidémies récurrentes de choléra, de rougeole et d'Ebola. La fragilité, les conflits et la violence, la faiblesse des systèmes de surveillance, l'insuffisance des infrastructures d'eau et d'assainissement, le manque d'accès à l'eau et l'insuffisance des réseaux de laboratoires dans tout le pays sont autant d'obstacles à l'identification et à l'endiguement rapides des épidémies. L'augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles (MNT) représente un risque important dans le contexte de la RDC, compte tenu de la faiblesse de son système de santé et de la mauvaise coordination entre les secteurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès dus aux MNT en Afrique devrait dépasser celui des maladies transmissibles et des décès périnataux combinés d'ici 2030. C’est une situation qui serait catastrophique pour la RDC.
Dernière mise à jour: 17 avr. 2025